J’ai promis de rendre compte de la présentation d’Hélène Duclos, consultante de l’association Culture et promotion, lors de l’apéro-asso du 28 septembre 2006. Cette association conduit des processus d’évaluation de l’utilité sociale dans différentes associations. Sa méthode m’intéresse parce qu’elle fait l’économie d’une définition du concept d’utilité sociale et propose des outils pragmatiques pour aider chaque acteur à produire et mettre en oeuvre sa propre représentation de l’utilité sociale. Cette démarche semble facilement transposable à l’accompagnement des fondateurs, les aider à formuler l’objet associatif et à le décliner dans le fonctionnement statutaire.
J’ai déjà donné ici un compte-rendu de la première partie de l’exposé relative aux enjeux des processus d’évaluation de l’utilité sociale.
La seconde partie de l’exposé d’Hélène Duclos est consacrée de la question de la méthode : comment conduire concrètement l’évaluation de l’utilité sociale ?
Le mode opératoire est construit autour de trois temps forts :
• La formulation d’une définition de l’utilité collective (appropriation et cadrage),
• La mise en oeuvre de l’évaluation (formulation de critères, mise en oeuvre d’outils de mesure)
• La restitution à l’association de l’image obtenue au terme de l’évaluation
La première étape vise à assurer la légitimité de la démarche sur le plan interne. Dans le tiers secteur, tout processus d’une organisation suppose de recueillir préalablement son consentement. Il faut garantir l’adhésion de toutes les parties prenantes à l’évaluation, sous peine de faire un flop. La première tache consiste donc à faire parler la communauté associative à propos de sa propre conception de l’utilité sociale. Dirigeants, bénévoles, salariés, usagers de l’association doivent construire ensemble une vision de l’utilité sociale de leur engagement au quotidien.
La solution mise ne oeuvre ici est originale ; Hélène Duclos postule l’absence de définition du concept d’utilité collective et invite l’organisme évalué à produire sa propre définition. En cela, elle signifie que l’évaluation de l’utilité collective par l’organisme est nécessairement « auto-référente », qu’elle renvoie à l’objet associatif et la manière dont il est traduit au quotidien.
Je trouve cette façon de faire très intéressante. Cela conduit la communauté associative à s’interroger à nouveau à propos de ses objectifs et de ses motivations.
Avec cette méthode, la définition de l’utilité sociale résulte toujours d’une négociation, de la confrontation entre les différentes visions des parties prenantes au projet associatif. Hélène Duclos parle même de « rapport de force ».
Une fois les buts de la structure reformulés en terme d’utilité collective peut commencer l’évaluation à proprement parler. Il s’agit de définir des critères propres aux activités de l’association et de concevoir des instruments de mesure tant quantitatifs que qualitatifs.
Une association qui se donne comme but de créer du lien social doit par exemple préciser qu’il s’agit de faciliter les relations entre des personnes d’âge et de cultures différents, indiquer la manière dont elle entend créer ces liens, par la parole et la réalisation d’activités communes, par exemple. Chacun de ces critères doit faire l’objet d’un outil de mesure. Il faut appréhender la production quantitative de l’association mais également restituer sa dimension qualitative.
Ici l’intervention de l’expert est indispensable pour produire une série d’indicateurs qui soient à la fois peu nombreux et simples à mettre en oeuvre. Dans certains cas, l’évaluation pose des difficultés spécifiques, par exemple, lorsque l’association s’adresse à un public de passage.
La dernière étape consiste à analyser les résultats donnés par cette batterie d’indicateurs dans un partage au sein de la structure. Soumis à la collectivité associative, le « retour » d’évaluation est d’autant plus fructueux que l’utilité sociale de la structure a fait l’objet d’une définition consensuelle.
Un petit schéma pour visualiser le processus d’évaluation et ses enjeux (schéma réalisé sous Mindmanager Pro 6, un outil formidable dont je parle ici).

 Quelques idées simples pour animer votre association 1901
Quelques idées simples pour animer votre association 1901 Utilité publique, intérêt général, utilité sociale (à ne pas confondre)
Utilité publique, intérêt général, utilité sociale (à ne pas confondre) Les 4 P pour établir l’utilité sociale de l’association loi 1901
Les 4 P pour établir l’utilité sociale de l’association loi 1901 Quelle est la valeur réelle de votre petite association ?
Quelle est la valeur réelle de votre petite association ?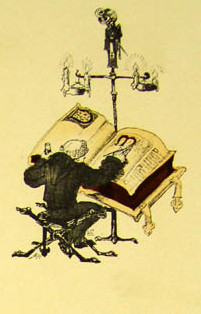 Le capital associatif, source de l’utilité sociale des associations de proximité
Le capital associatif, source de l’utilité sociale des associations de proximité
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.